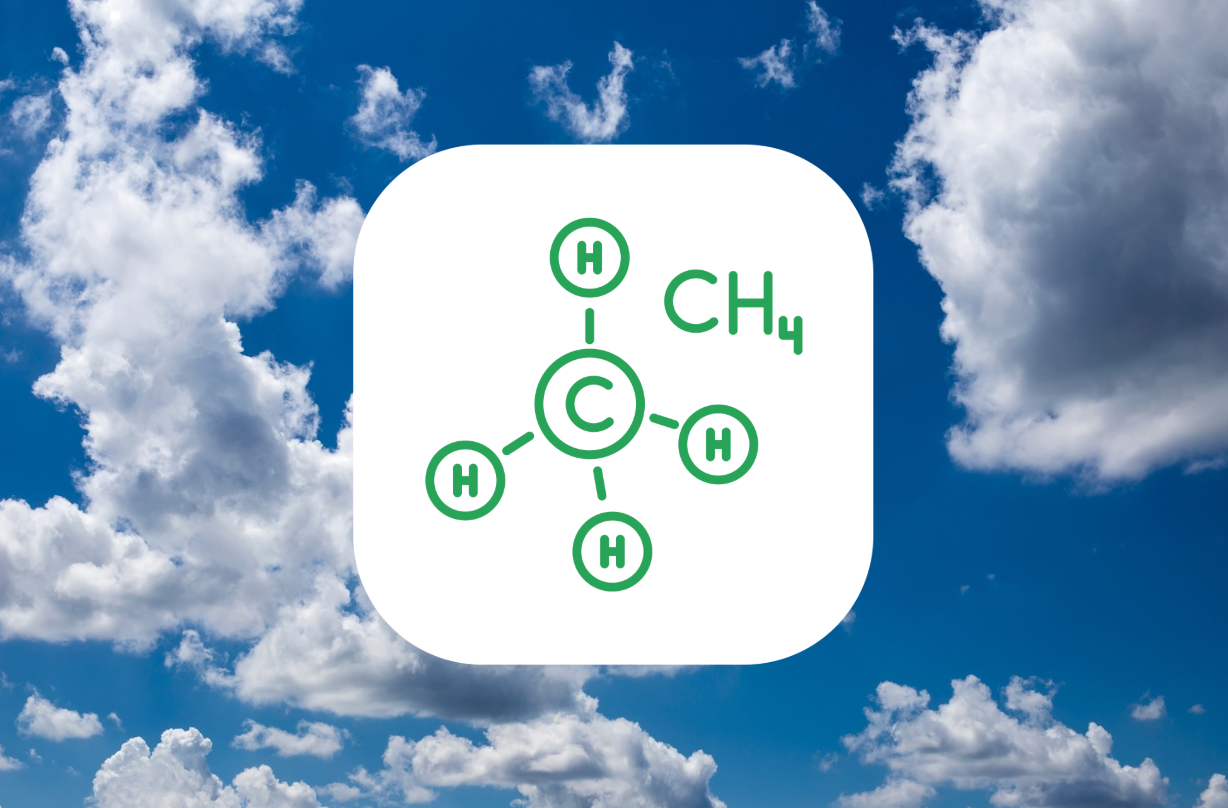La reconstitution de la couche d’ozone se confirme – OMM
Par : Sophie Sanchez

[
D.R.
Les données scientifiques du Bulletin de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) sur l’ozone et le rayonnement publié le 16 septembre 2025 confirment que la couche d’ozone, qui protège la Terre et agit comme un filtre contre certains rayons UV cancérigènes, est en voie de reconstitution : sur une grande partie du globe, la couverture totale d’ozone stratosphérique était meilleure en 2024 que les années précédentes.
« Il y a quarante ans, les nations se sont rassemblées pour prendre les premières mesures de protection de la couche d’ozone, guidées par la science et unies dans l’action », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, cité dans le communiqué. « La Convention de Vienne et son Protocole de Montréal sont devenus un succès multilatéral de référence. Aujourd’hui, la couche d’ozone est en voie de rétablissement. Cette réussite nous rappelle que lorsque les nations tiennent compte des avertissements de la science, des progrès sont possibles », a-t-il ajouté dans une allusion à peine voilée à la politique anti-science menée outre-Atlantique par le président américain Donald Trump.
[
Action internationale concertée
Le Bulletin de l’OMM sur l’ozone, rendu public à l’occasion de la Journée mondiale de la couche d’ozone, précise qu’en 2024, le « trou » dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique – qui se forme chaque printemps – a présenté une profondeur inférieure à la moyenne de la période 1990-2020, avec une déperdition maximale d’ozone de 46,1 millions de tonnes le 29 septembre. Il est donc plus petit que les « trous » relativement importants relevés entre 2020 et 2023. En outre, l’apparition de ce trou au-dessus de l’Antarctique a été relativement lente – et « cette apparition tardive qui devient habituelle est un signal fort du début de reconstitution de la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique », précisent les auteurs du Bulletin.
Ce faible niveau d’appauvrissement de la couche d’ozone observé en 2024 est en partie dû à des facteurs atmosphériques naturels qui entraînent des fluctuations d’une année sur l’autre.
Toutefois, la tendance positive à long terme est le fruit d’une action internationale concertée, insiste l’OMM. Les scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme pour la première fois en 1975, avec la déclaration de l’OMM sur les modifications de la couche d’ozone résultant des activités de l’homme et leurs éventuelles conséquences géophysiques.
L’année 2025 est justement le 40e anniversaire de la Convention de Vienne, accord international qui a posé en 1985 la première pierre de la protection mondiale de la couche d’ozone stratosphérique. Les signataires de cette convention ont fourni un cadre pour la coopération internationale en matière de recherche sur l’ozone, d’observations systématiques et d’évaluations scientifiques dans ce domaine.
La convention de Vienne a constitué la base du Protocole de Montréal, adopté deux ans plus tard en 1987, qui réglemente l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone, et notamment les chlorofluorocarbures (CFC). À ce jour, comme s’en félicite l’OMM, le Protocole de Montréal a permis d’éliminer progressivement plus de 99 % de la production et de la consommation de substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone, qui étaient utilisées à des fins de réfrigération et de climatisation ainsi que dans des mousses anti-incendie et même dans des laques pour cheveux.
Par conséquent, précise l’OMM, la couche d’ozone devrait retrouver ses niveaux des années 1980 d’ici au milieu de ce siècle, ce qui réduira considérablement les risques de cancer de la peau, de cataracte et de dégradation des écosystèmes dus à une exposition excessive aux rayons ultraviolets (UV). En effet selon le dernier rapport d’évaluation, publié en 2022, si les politiques actuelles restent en vigueur, la couche d’ozone devrait retrouver les valeurs de 1980 d’ici à 2066 environ au-dessus de l’Antarctique, à 2045 au-dessus de l’Arctique et à 2040 dans le reste du monde. La prochaine évaluation aura lieu en 2026.
[
L’amendement de Kigali
L’OMM rappelle que dans le cadre du Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SAO) (1987), un amendement a été adopté en 2016 à Kigali (Rwanda) pour intégrer les HFC aux « substances réglementées » du point de vue de leur production et de leur consommation. Même si les HFC ne sont pas des SAO, ce sont de puissants gaz à effet de serre (GES) utilisés comme gaz de substitution de 2ème génération aux CFC, après les HCFC (tous deux étant des SAO). Les intégrer au protocole de Montréal visait à être plus efficace dans la réduction de leur utilisation et leurs émissions que les autres réglementations qui visaient seulement la réduction des émissions.
L’amendement de Kigali a ajouté 18 espèces de HFC au Protocole de Montréal et a défini des calendriers de réduction progressive de la production et de la consommation, d’une part pour les pays industrialisés et, d’autre part, pour les pays en développement (PED). L’objectif à terme est de parvenir à une réduction de 85 % de la production/consommation par rapport aux années de référence d’ici 2036 pour les pays industrialisés et d’ici 2045 ou 2047 pour les PED.
L’amendement de Kigali, texte juridiquement contraignant, est entré en vigueur le 1er janvier 2019, échéance prévue par l’amendement lui-même, à condition d’avoir été ratifié par 20 Parties. Cette condition a été remplie le 17 novembre 2017, lors de la COP-23, après ratification par la 20e Partie, la Suède. Cet amendement a été ratifié par 164 Parties à ce jour. La réduction progressive de la production et de la consommation de HFC progresse conformément aux calendriers convenus et devrait permettre d’éviter jusqu’à 0,5 °C de réchauffement planétaire d’ici à la fin du siècle actuel, précise l’OMM.
[
[
Importance de la surveillance mondiale
À l’appui du Protocole de Montréal, la communauté de spécialistes dirigée par l’OMM a élaboré et mis en œuvre des principes directeurs pour le fonctionnement des réseaux de surveillance de l’ozone et des UV. Ces principes visent à assurer une large couverture d’observation, à normaliser les opérations, le traitement des données et l’étalonnage, et à favoriser la constitution d’un réseau où les scientifiques se rencontrent, échangent des connaissances, reçoivent une formation et étudient des possibilités de collaboration.
Cette démarche s’est révélée extrêmement utile pour ce qui est de réaliser efficacement des observations ayant un intérêt pour la prise de décisions, et elle représente l’une des clés du succès du Protocole de Montréal, peut-on lire dans l’un des articles du Bulletin, consacré aux instruments de mesure et aux campagnes de comparaison connexes.
« Les recherches scientifiques de l’OMM sur la couche d’ozone remontent à plusieurs décennies. Elles reposent sur la confiance, la collaboration internationale et l’engagement en faveur de l’échange de données sans restriction, autant de pierres angulaires de l’accord environnemental le plus fructueux au monde », a souligné la Secrétaire générale de l’OMM, Celeste Saulo.
« En dépit des excellents résultats du Protocole de Montréal ces dernières décennies, le travail n’est pas encore terminé, et il est essentiel que les acteurs mondiaux continuent de surveiller systématiquement et attentivement l’ozone stratosphérique ainsi que les substances appauvrissant la couche d’ozone et leurs produits de substitution », a ajouté Matt Tully, président du Groupe consultatif scientifique de l’OMM pour l’ozone et le rayonnement ultraviolet solaire.
[
En savoir plus
Bulletin de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) sur l’ozone et le rayonnement- 2024
Bulletin de l’OMM sur l’ozone et le rayonnement – 2022
Ozone stratosphérique : l’OMM publie un nouveau bulletin annuel – Citepa