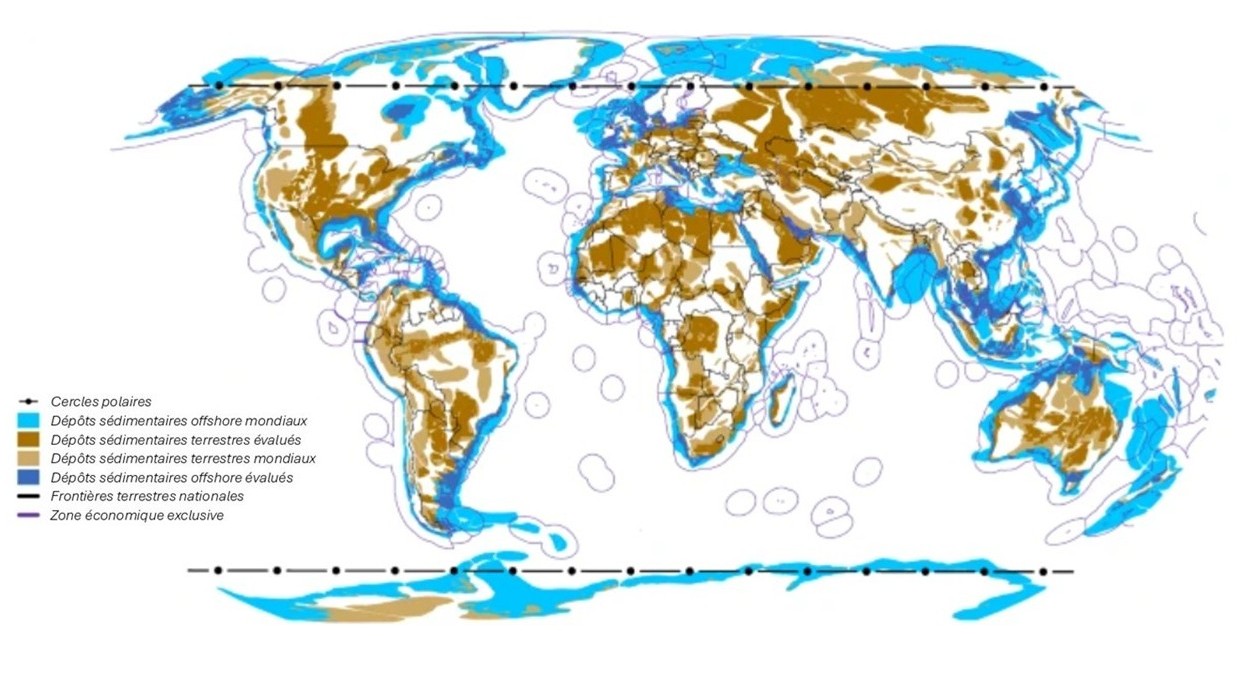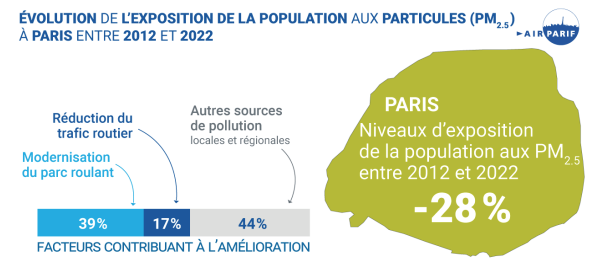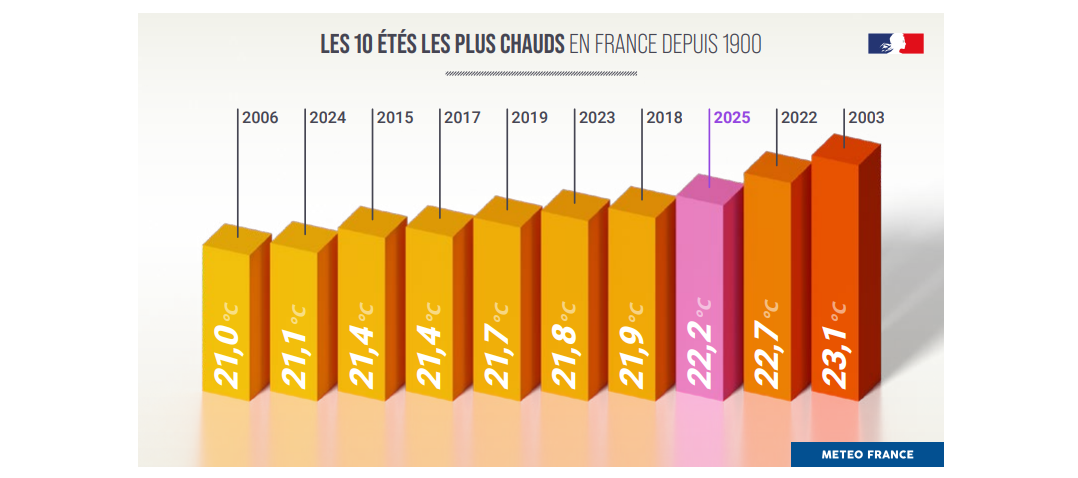Label bas-carbone : une révision qui fait débat
Par : Sophie Sanchez
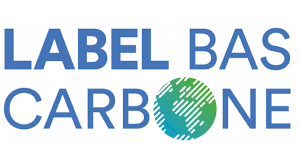
Après six ans d’existence, le label bas-carbone, le premier cadre de certification climatique volontaire en France créé en 2018, a été révisé en profondeur. Le ministère de la Transition écologique a indiqué dans un communiqué publié le 8 septembre 2025 vouloir « accélérer les financements, simplifier le montage de projet, et améliorer la transparence et la robustesse » de ce dispositif règlementaire. Un décret et un arrêté du 5 septembre 2025 sont parus au Journal officiel du 7 septembre 2025.
Au terme du nouveau décret, les porteurs de projets pourront se faire rémunérer par un partenaire volontaire (acteur public ou privé), qui se verra attribuer des crédits carbone, générés par les projets labellisés. Ces derniers seront reconnus à la suite d’une vérification. Les crédits carbone peuvent notamment être utilisés pour la contribution ou la compensation volontaire des émissions.
Cette révision fait débat sachant que dans la version précédente du décret, qui avait été révisé en 2021, « les réductions d’émissions n’étaient ni transférables, ni échangeables – et ce que ce soit de gré-à-gré ou sur quelque marché volontaire ou obligatoire que ce soit ». Au-delà, le seuil pour évaluer les projets forestiers proposés, censés apporter une réduction d’émissions additionnelle et donc un avantage environnemental par rapport à ce que génèrerait une friche, est jugé trop favorable par certains experts.
[
Contexte
Créé par le décret n° 2018-1043 (publié au JO le 29 novembre 2018), et précisé par un arrêté publié le même jour, le label bas-carbone visait à favoriser l’émergence de projets additionnels de réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire français, par la mise en place d’un cadre de suivi, notification et vérification des émissions de GES, permettant la valorisation de réductions d’émissions additionnelles, réalisées volontairement par des personnes physiques ou morales dans des secteurs d’activité variés.
Depuis sa création, le label bas-carbone (LBC) a beaucoup évolué :
- Élargissement du périmètre : initialement concentré sur la forêt et l’agriculture, il couvre désormais une dizaine de secteurs différents (bâtiment, transport, déchets, etc.) avec des méthodologies validées ;
- Professionnalisation du marché : limité au départ à des projets pilotes (petits volumes, financés par quelques entreprises engagées), le marché s’est structuré avec une offre plus diversifiée et une demande croissante ;
- Standardisation & rapportage (MRV – Measuring, Reporting and Verification) : les méthodes de suivi, vérification et certification ont été réhaussées pour renforcer l’intégrité environnementale du dispositif ;
- Reconnaissance institutionnelle : le LBC est désormais intégré dans les politiques publiques (stratégie nationale bas-carbone, réglementation, incitations financières) ;
- Préparation à l’articulation européenne : adaptation progressive pour être compatible avec les futures normes européennes (notamment le CRCF – Cadre de certification de l’UE pour les absorptions de carbone).
En outre, le système est évolutif – les méthodes d’évaluation sont constamment révisées – et un comité rassemblant les meilleurs experts du domaine a été mis en place, ce qui est un gage de contrôle qualité.
Depuis sa création, près de 2 000 projets ont été labellisés, représentant plus de 7 millions de tonnes d’équivalent CO2 évitées ou séquestrées, principalement en agriculture et en forêt, selon les chiffres du ministère.
Dans ce contexte, le nouveau décret 2025-917 du 5 septembre 2025 vise à
- Encadrer et clarifier le label bas carbone pour assurer une compatibilité avec les exigences de reporting (dont la CSRD) ;
- Attester une traçabilité pour garantir la confiance dans les crédits carbone ;
- Eviter leur double compte par le retrait irréversible et la déclaration de cession ;
- Dynamiser le marché et attirer de nouveaux financeurs.
[
Réduction d’émissions transformées en crédits carbone cessibles
[
Jusqu’ici, les réductions d’émissions, une fois reconnues à la suite d’une vérification, n’étaient ni transférables, ni échangeables – que ce soit de gré-à-gré ou sur quelque marché volontaire ou obligatoire que ce soit. Désormais, les « réductions d’émissions » sont transformées en crédits carbone, qui sont eux-mêmes cessibles après vérification.
Les projets labellisés produisent des réductions d’émissions certifiées selon des méthodes approuvées. Concrètement, une réduction d’émissions ou une absorption vérifiée (par rapport à un scénario de référence) donne lieu à la délivrance d’unités (crédits carbone). Le fait que ces crédits carbone soient cessibles signifie que le porteur de projet peut les vendre ou les transférer à un tiers (entreprise, collectivité, particulier), qui pourra les utiliser pour une compensation obligatoire, volontaire ou une contribution. En outre, les vendeurs pourront bénéficier d’une avance sur un contrat de vente, les crédits carbone étant mis plus tard sur le marché.
Toutes les cessions de crédits carbone doivent être déclarées dans un registre, ce qui crée un marché où la valeur économique des réductions/absorptions peut financer les projets. À noter, les crédits carbone ne peuvent pas être utilisés en vue de l’atteinte des objectifs fixés par les contributions déterminées au niveau national (CDN) prévues par l’Accord de Paris.
Afin d’assurer l’intégrité environnementale du dispositif, l’additionnalité d’un projet doit être démontrée par rapport à un scénario de référence, autrement dit le fait qu’il apporte une réduction d’émissions additionnelle, un surplus environnemental. Les crédits carbone ne peuvent être générés que par des projets additionnels labellisés.
La réduction d’émissions ou leur séquestration par un projet sont dites additionnelles lorsqu’elles ne se seraient pas produites dans le cadre du scénario de référence (par exemple, le fait de laisser un terrain forestier en friche).
Seules les réductions d’émissions et les séquestrations allant au-delà de ce scénario de référence, – en d’autres termes, au-delà des obligations découlant des textes législatifs et règlementaires en vigueur, des incitations à générer des crédits carbone déjà existantes comme les aides publiques ou les crédits d’économie d’énergie, des pratiques courantes en vigueur dans le secteur d’activité correspondant au projet ou encore des évolutions prévues par la SNBC -, sont reconnues dans le cadre du label. L’enjeu est alors la robustesse de la méthode de certification qui doit suivre les meilleurs standards internationaux pour que le projet soit réellement additionnel.
Pour mettre en place des garde-fous, le système de traçabilité est institutionnalisé avec un site public qui fournira des informations détaillées sur les projets et un registre interne accessible aux demandeurs, financeurs et auditeurs, ce qui contribue à professionnaliser le système et à le rapprocher des systèmes de labellisation internationaux.
En outre, le suivi et la transparence sur les usages des crédits seront accrus : il faudra désormais déclarer si le projet relève d’une compensation volontaire ou obligatoire. Les cessions seront également déclarées : le registre enregistrera quels crédits ont été cédés, par qui et dans quel but.
Lorsqu’il s’agit d’un crédit carbone ex ante, autrement dit dont la vérification a eu lieu alors que la réduction d’émissions ou la séquestration n’a pas encore été pleinement effectuée, le label bas carbone certifie une trajectoire probable avec un rabais obligatoire de 10 % minimum. Lorsqu’il s’agit d’un crédit carbone ex post, dont la vérification a eu lieu après la réalisation effective des réductions d’émissions ou de la séquestration qui y sont liées, le label bas-carbone certifie une réduction observée.
Les vérifications et contrôles sont renforcés : le préfet peut faire réaliser des contrôles inopinés et retirer le label en cas de fraude. Des exigences accrues sont requises pour les auditeurs avec une liste d’auditeurs accrédités. Une vérification documentaire et sur place est prévue si la méthode le permet. Les données sont conservées pendant trois ans. La possibilité d’annuler des crédits carbone est désormais prévue.
En parallèle, des règles plus strictes sont définies concernant la communication qui doit être associée à une communication sur les efforts et actions préalables de réductions d’émissions du bénéficiaire. Le caractère provisoire des projets doit être obligatoirement mentionné dans le cas de crédits ex ante.
À noter, les dispositions de l’arrêté s’appliquent rétroactivement et avec effet immédiat à tous les projets label bas carbone en cours de notification, de dépôt, déjà labellisés et en cours de validité ainsi que les projets déjà vérifiés. En outre, les dispositions des articles 28 – transparence sur la participation au financement d’un projet non vérifié – et 29 – transparence sur l’acquisition des crédits carbone – s’appliquent de manière rétroactive pour les projets en cours de validité et inscrits dans le registre du label bas carbone dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de l’arrêté.
Une révision qui fait débat
La réforme du label bas carbone fait débat. Ainsi, Olivier Picard, directeur du service C+For, forêt et carbone au CNPF (Centre national de la propriété forestière) estime que « Rendre les crédits carbone cessibles n’est pas une bonne initiative, ce n’est pas cohérent avec la philosophie du label bas carbone fondée sur le volontariat et la contribution climatique des entreprises. De plus, il s’agit d’un accord de gré à gré entre le financeur qui reçoit les crédits carbone et le forestier qui bénéficie de l’argent de l’entreprise pour adapter sa forêt. Or la cessibilité transforme cette contribution en actif financier, et transforme de ce fait la relation entre les parties ». Toutefois, il relève que cette cessibilité risque de devenir nécessaire pour être en accord avec le futur cadre d’absorption européen (CRCF).
D’autres parties s’interrogent sur le respect de l’additionnalité apportée par les projets qui seront labellisés. Dans les projets forestiers proposés au titre de la compensation carbone, le projet doit apporter, comme le précise le décret, une réduction d’émissions additionnelle par rapport à un scénario de référence (qui correspond à celui où un terrain est laissé en friche).
En 2018, lors de la création du label, il avait été estimé que la régénération naturelle des friches générait en moyenne un mètre cube de bois commercialisable par hectare et par an – et c’est cette valeur qui a finalement été retenue en août 2025. Or des chercheurs de l’Institut national de recherches pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) membres du groupe scientifique et technique du label, cités par « Le Monde », jugent ce seuil trop bas, dans la mesure où la croissance spontanée de la végétation arborée est, d’après leurs estimations, plutôt en moyenne de 4 à 5,3 m3/ha/an pour les forêts hexagonales. Ils estiment que le seuil de 1 m3/ha/an risque de conduire à surestimer l’impact additionnel en termes de stockage de CO2 de projets de reboisement et, par voie de conséquence, à amoindrir la valeur du label. Pour certaines forêts qui ont été détruites il y a plus de dix ans, le seuil de régénération naturelle peut même atteindre, d’après une autre source, de 5 à 8 m3/ha/an.
« Il y a eu une proposition raisonnable d’actualisation du scénario de référence pour tenir compte de nouvelles données scientifiques, en attendant des données plus complètes avec un échantillon plus étendu », indique à cet égard Olivier Picard. « Nous savons dès à présent que le scénario de référence devra évoluer, reste à se mettre d’accord sur les modalités », poursuit-il.
« La discussion va se poursuivre, nous avons proposé de réunir un groupe d’utilisateurs forestiers du label bas carbone comme il en existe un sur la partie agricole afin de réunir les opérateurs. Nous allons œuvrer pour notre part pour que le label bas carbone continue à s’appuyer sur des données scientifiques et des méthodes robustes et assises sur des retours terrain fiables », conclut-il.
[
Différents types de crédits carbone
Le décret distingue plusieurs catégories de crédits carbone afin de bien distinguer les différents projets :
- Crédits de réduction d’émissions : les crédits carbone de réductions d’émissions désignent des crédits carbone générés par une réduction des quantités de gaz à effet de serre émises dans le scénario de projet par rapport aux émissions générées dans le scénario de référence. Cela correspond à éviter qu’une tonne de CO₂ (ou équivalent) ne soit émise par rapport à une situation de référence ;
- Crédits de séquestration (ou absorption) : les crédits carbone de séquestration désignent des crédits carbone générés par une augmentation de la séquestration de carbone dans le scénario de projet par rapport au scénario de référence. Ils peuvent également être désignés comme des crédits carbone d’absorption ;
- Crédits directs : les crédits carbone directs correspondent à la réduction d’émissions qui aurait été générée par des sources couvertes par le périmètre du projet ou à la séquestration d’émissions par des puits sur ce périmètre. Celles-ci sont communément appelées « émissions du scope 1 ». Ils sont ainsi évalués à l’échelle du projet ;
- Crédits indirects : les crédits carbone indirects sont les réductions d’émissions liées à la production de l’énergie importée par les activités couvertes par le projet ou les réductions d’émissions liées à la chaîne de valeur complète des activités couvertes par le projet (déplacement des salariés, production des matières premières, transport amont ou aval des marchandises, utilisation ultérieure des produits vendus, etc.). Celles-ci correspondent aux émissions communément appelées « émissions du scope 2 ou du scope 3 ». Ils résultent ainsi d’effets induits en dehors du périmètre immédiat du projet.
[
En savoir plus
Retrouvez le décret modifiant le décret de création du label bas carbone
Consultez l’arrêté définissant le référentiel du label bas carbone
Label bas-carbone : création du groupe scientifique et technique – Citepa