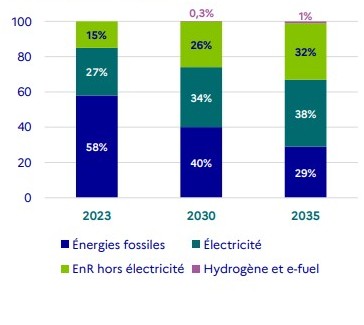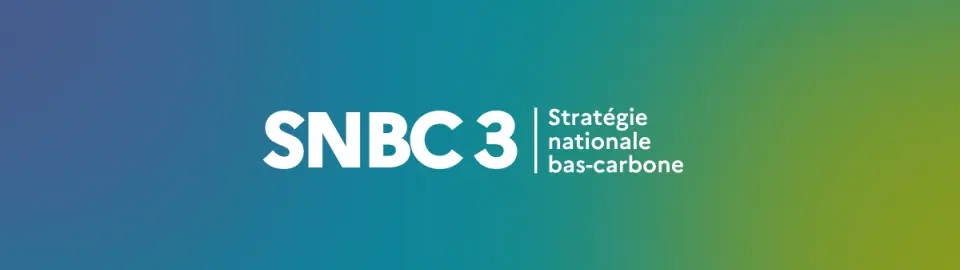Climat : les ministres de l’Environnement des Vingt-Sept États membres de l’Union européenne concluent un accord à l’arraché sur l’objectif 2040 et le jalon 2035
Par : Sophie Sanchez

© Pixabay – Pete Linforth
[
À l’arraché, à quelques heures seulement de l’ouverture à Belém, au Brésil, de la COP 30, la conférence des Nations unies sur les changements climatiques, les ministres de l’Environnement des Vingt-Sept États membres de l’Union européenne (UE), réunis lors d’un conseil extraordinaire, sont parvenus le 5 novembre 2025 au matin après des heures de négociation à un accord à la majorité qualifiée sur la modification de la loi européenne sur le climat (European Climate Law) en fixant un objectif de réduction d’émissions pour 2040. Ils ont également conclu un accord à l’unanimité cette fois sur l’établissement de la « contribution déterminée au niveau national » (CDN en français, NDC en anglais) de l’UE pour 2035.
Au titre de l’Accord de Paris sur le climat, conclu il y a dix ans, chaque pays doit communiquer tous les cinq ans aux Nations unies un objectif chiffré de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’un plan pour y parvenir afin de contribuer à l’effort mondial de lutte contre le changement climatique. La CDN de l’UE devait donc être mise à jour. Or fixer le jalon 2035 nécessitait de déterminer l’objectif pour 2040, un acte interne juridiquement contraignant.
« Ce texte [de compromis sur l’objectif 2040] a été adopté un petit peu dans la douleur mais finalement par une vaste majorité des États membres », a expliqué Monique Barbut, la toute nouvelle ministre de la Transition écologique lors d’un point presse le 5 novembre. « Les négociations ont été difficiles, le contexte international a pesé lourd sur l’ensemble des négociateurs », a-t-elle ajouté. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie ont voté contre le texte, tandis que la Belgique et la Bulgarie se sont abstenues.
Le Danemark, qui assure la présidence tournante de l’Union européenne au second semestre 2025, a multiplié les compromis car l’absence d’accord sur l’objectif 2040 n’aurait pas permis d’adopter la CDN de l’UE pour 2035, ce qui, à la veille de l’ouverture de la COP 30, aurait constitué une « catastrophe diplomatique », comme l’indiquait un spécialiste du dossier. Mais les conditions et flexibilités sont tellement nombreuses que l’objectif de réduction d’émissions de 90% d’ici 2040 (par rapport aux niveaux de 1990), s’il est toujours affiché, semble désormais très théorique et que ce que le ministère français de la Transition écologique (MTE) présente comme « un accord historique » a été en partie vidé de sa substance.
[
[
Flexibilités et compromis
Le Conseil de l’Union européenne (UE), – qui réunissait en l’occurrence les ministres de l’Environnement des Vingt-Sept États membres de l’UE -, a, indique le communiqué de presse du Conseil, « maintenu l’objectif contraignant de réduction de 90 % des émissions nettes de GES d’ici 2040 [par rapport aux niveaux de 1990] proposé par la Commission [européenne] » sachant que cet objectif a été recommandé par le Conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (Scientific advice for amending the European Climate Law – Setting climate goals to strengthen EU strategic priorities). « Le Conseil a toutefois apporté quelques ajustements afin de tenir compte des préoccupations relatives à la compétitivité de l’UE, à la nécessité d’une transition juste et socialement équilibrée, à l’incertitude liée aux absorptions naturelles et à la diversité des situations nationales dans les États membres », ajoute le texte.
En cela, les ministres de l’Environnement ont suivi les nombreuses conditions fixées par les chefs d’État et de gouvernement jeudi 23 octobre qui ont invoqué la nécessité de combiner protection du climat et compétitivité (lire notre article). « Dans le contexte des droits de douane américains et des subventions chinoises, il faut accompagner les entreprises européennes et garantir que l’effort soit juste et partagé », explique-t-on à cet égard au ministère de la Transition écologique (MTE).
[
En l’occurrence, de nombreuses conditions et flexibilités ont été prévues par les ministres de l’Environnement, comme l’a précisé Monique Barbut :
- la possibilité d’acquérir, à partir de 2036, des « crédits carbone internationaux de haute qualité » pour apporter une « contribution adéquate » à l’objectif de 2040, dans une proportion fixée non pas à 3 % comme l’avait proposé la Commission en juillet 2025, mais à 5 % sur les 90 %, et en prévoyant, en outre, au préalable une période pilote pour la période 2031-2035 attendu qu’il s’agit d’un mécanisme nouveau ;
- une clause de révision sur l’objectif de réduction d’émissions de 55% en 2030 « pour être sûrs que tous les engagements pris sont tenus » ;
- la prise en compte de l’incertitude sur les puits de carbone avec un « frein d’urgence » qui pourrait être déclenché si ceux-ci venaient à sous-performer ;
- la mise en place d’un critère de préférence européenne dans la réglementation sur les émissions de CO2 des véhicules pour soutenir la transition de la filière automobile.
La France avait, en outre, obtenu il y a plusieurs semaines la reconnaissance de la « neutralité technologique », autrement dit que l’énergie nucléaire puisse être prise en compte au titre de la décarbonation de l’énergie.
« L’accord porte bien [sur une réduction d’émissions] de 90 % dont 5 % qui peuvent être un élément de flexibilité, c’est-à-dire [un engagement de baisse de] 85 % plus jusqu’à 5 % [de recours aux crédits carbone internationaux] pour arriver à 90 %, le recours aux 5 % étant une faculté donnée aux États et non une obligation », a précisé la ministre. « Il n’y a pas de 5+5 » a-t-elle assuré, « c’est bien une flexibilité de 5 % [qui est accordée] avec [via] la clause de révision la possibilité de rediscuter de ce 5 % en l’augmentant si besoin », a-t-elle argumenté. « L’Italie avait demandé [que le recours aux crédits carbone internationaux puisse atteindre] 10%, ce n’est pas ce qui est dans le texte [qui a été adopté] », a-t-elle encore fait valoir.
« Dans les négociations européennes, deux lignes différentes se sont dessinées : d’un côté, la volonté de certains pays de réduire de manière certaine les émissions brutes, hors puits de carbone, en poussant les secteurs économiques à réaliser des évolutions structurelles ; de l’autre, à l’inverse, celle d’abaisser les ambitions et d’accepter un plus haut degré d’incertitudes. C’est clairement la seconde voie qui a été choisie, ce qui explique les nombreuses flexibilités mises en place », regrettent Simon Martel et Violette de la Croix, chercheurs chez I4CE (Institut d’économie pour le climat).
[
Crédits carbone internationaux
La Commission européenne avait proposé le 2 juillet 2025 « la possibilité d’une utilisation limitée de crédits carbone internationaux de haute qualité par les pays partenaires », en d’autres termes d’autoriser les Vingt-Sept pour contribuer à la réduction de leurs émissions à prendre en compte, à partir de 2036, l’acquisition de crédits carbone internationaux à hauteur de 3 % du total de l’objectif de – 90%, afin de financer des projets vertueux hors d’Europe – sachant que l’article 6 de l’Accord de Paris régit spécifiquement la coopération internationale volontaire en matière d’atténuation.
La France a proposé, un souhait partagé par « beaucoup de nos partenaires », que cette flexibilité soit portée à 5 %. Monique Barbut a fait valoir que l’Europe pèse 6 % des émissions mondiales, une proportion qui ne dépassera pas 4 % dans quelques années. Les efforts de l’UE pour réduire ses émissions auront donc moins d’impact sur le réchauffement climatique mondial. Contribuer à réduire les 94 % restants est donc tout aussi stratégique.
Du côté du MTE, on rappelle en outre que les crédits carbone internationaux sont un instrument dont le principe a été validé en 2024 lors de la COP 29 à Bakou (Azerbaïdjan). Si, par le passé, certains de ces instruments n’étaient pas à la hauteur des promesses faites en termes de réductions d’émissions, désormais des critères d’intégrité environnementale sont mis en œuvre et respectés pour valider les actions de décarbonation ou de séquestration réalisées à l’extérieur de l’UE, assure-t-on au MTE.
En outre, abattre les tonnes de carbone coûte de plus en plus cher et est de plus en plus difficile à mesure que l’on avance dans le temps. En 2036, l’essentiel des efforts devrait avoir été réalisé et notamment la fermeture des centrales à charbon en Pologne et en Allemagne. Dès lors, une fois ces actes forts réalisés, continuer à décarboner l’économie et notamment les transports et le logement sera nettement plus complexe. Dans ce contexte, la possibilité de recours aux crédits carbone internationaux à partir de 2036 permettra d’abattre du CO2 à moindre coût en investissant dans les pays en développement dans des solutions fondées sur la nature comme replanter des forêts ou construire des centrales solaires, argumente-t-on au MTE. Autrement dit, avec le même milliard d’euros, il sera possible d’abattre beaucoup plus de tonnes de carbone avec une plus grande efficacité, ce qui constituera en outre un vecteur de solidarité et de partenariats avec les pays du Sud.
La question du financement de ces crédits n’a pas été encore été réglée dans le cadre de l’accord conclu à Bruxelles. La France considère que chaque État membre doit les payer, ces crédits relevant de la contribution nationale. Mais « le débat n’a pas été clos », a confié à ce sujet Monique Barbut : « certains pays de l’UE souhaiteraient que la Commission prenne en charge ce financement au travers des crédits alloués aux questions climatiques, ou au travers de l’augmentation du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières », le MTE étant pour sa part « à l’aise avec chacune des deux options ».
[
« Un changement de paradigme qui pose question »
« La position de l’Union européenne a longtemps été de ne pas recourir aux crédits carbone internationaux afin de favoriser des réductions brutes des émissions de gaz à effet de serre au sein des Vingt-Sept, rappelle Simon Martel, chercheur chez I4CE (Institut d’économie pour le climat). Autoriser le recours à ces crédits constitue un changement de paradigme risqué alors que nous ne connaissons pas encore les modalités permettant de s’assurer de la qualité des projets. » « Si un référentiel international a été prévu par la COP 29 à Bakou, la fiabilité de ces crédits reste un pari et beaucoup d’interrogations persistent sur l’additionnalité réelle de certains projets de séquestration carbone », renchérit Violette de la Croix, responsable des clubs climat Agriculture Alimentation et Forêt Bois chez I4CE.
En outre, les estimations de la Commission européenne concernant le puits forestier semblent trop optimistes avec des objectifs de séquestration par les écosystèmes de 310 MtCO2e en 2030 et de 370 MtCO2e en 2040. « Il aurait été préférable que la Commission parte sur des objectifs plus conservateurs sur les puits de carbone assortis de réductions d’émissions brutes plus importantes pour les autres secteurs », ajoute Simon Martel.
Concernant la révision de la cible également prévue par l’accord conclu à Bruxelles (voir ci-dessous), les deux chercheurs notent que trois facteurs suscitent l’affaiblissement des puits de carbone : deux sont liés au changement climatique – la mortalité des arbres et le ralentissement de leur croissance ; le troisième aux prélèvements opérés pour répondre aux besoins de décarbonation d’autres secteurs (matériaux pour la construction ou bois énergie). « Il est essentiel qu’une claire différenciation soit faite entre ces facteurs et que la cible de – 90% ne soit pas révisée pour pallier une baisse du puits due à des prélèvements trop importants, ces derniers pouvant être en partie planifiés et pilotés par les politiques publiques », insistent-ils.
[
[
Clause de révision de l’objectif pour 2030
Les chefs d’État et de gouvernement réunis jeudi 23 octobre 2025 dans le cadre du Conseil européen ont donné leur feu vert à l’objectif de – 90% pour 2040 proposé par la Commission européenne en posant notamment « la nécessité d’une clause de révision, compte tenu des données scientifiques les plus récentes, des progrès technologiques et de l’évolution des défis et des opportunités pour la compétitivité de l’UE à l’échelle mondiale. »
Cette clause de révision a été validée par les ministres de l’Environnement. Ainsi le communiqué indique que « La position du Conseil introduit également une évaluation bisannuelle afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs intermédiaires, sur la base des dernières données scientifiques, des avancées technologiques et de la compétitivité mondiale de l’UE. »
« Les États membres ont précisé et renforcé la clause de révision de la législation européenne existante en matière de climat. La révision portera notamment sur l’état des absorptions nettes au niveau de l’UE par rapport à ce qui serait nécessaire pour atteindre l’objectif de 2040, ainsi que sur l’évolution des défis et des possibilités d’amélioration de la compétitivité mondiale des industries de l’UE. La révision tiendra également compte de l’évolution des prix de l’énergie et de leur incidence sur les industries et les ménages », ajoute le document.
« Sur la base des conclusions de la révision et, le cas échéant, la Commission devra proposer une révision de la législation sur le climat. Cela peut inclure l’ajustement de l’objectif pour 2040 ou d’autres mesures supplémentaires visant à renforcer le cadre favorable, à savoir garantir la compétitivité, la prospérité et la cohésion sociale de l’UE », précise encore le texte.
La mise en place de cette clause peut sembler étonnante alors que l’UE se rapproche de la réalisation de ses objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et, collectivement, de la réduction contraignante de 55 % des émissions de gaz à effet de serre (lire notre article). En effet, selon l’évaluation par la Commission rendue publique dès fin mai 2025 des plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNIEC) des États membres, la mise en œuvre intégrale de ces plans nationaux définitifs, ainsi que des mesures nationales existantes et de la législation de l’UE déjà en place, permettrait de réduire les émissions nettes de GES d’environ 54 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et d’étendre considérablement les mesures en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Les plans mis à jour démontraient également un meilleur alignement sur le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » et une meilleure coordination entre les secteurs.
[
« Frein d’urgence »
Les absorptions de carbone, comme les forêts et les sols, sont estimées à +/- 7% à l’échelon national français. Mais ces puits de carbone risquent de voir leur capacité à absorber le CO2 diminuer. La forêt en France subit les effets du changement climatique du fait de l’intensification des sécheresses et des incendies et du développement massif de parasites. Une problématique à laquelle sont également confrontés les autres pays européens et de nombreux autres pays dans le monde.
C’est pourquoi un bilan sera établi en la matière. « Un mécanisme, le frein d’urgence, sera prévu et s’activera proportionnellement à la baisse du rendement des puits de carbone et conduira à la réévaluation de la cible [de la baisse d’émissions de GES à atteindre] ». « Nous ne souhaitions en aucun cas que la sous-performance des forêts et des autres puits de carbone soit reportée sur la charge de baisse des émissions et notamment pas sur l’industrie », précise-t-on à cet égard au MTE.
[
Fourchette de réduction d’émissions pour le jalon 2035
Face aux divisions qui se faisaient jour au sein de l’UE sur les engagements climatiques, la présidence danoise avait proposé en septembre 2025 le principe d’un « objectif indicatif » de réduction des émissions de GES – en l’occurrence une fourchette large comprise entre – 66,25 % et – 72,5 % d’ici 2035. C’est cette fourchette qui a été reprise et confirmée dans l’accord conclu le 5 novembre 2025, or seul le haut de la fourchette – une réduction des émissions de 72,5 % – correspond à la trajectoire permettant d’atteindre ensuite les – 90% en 2040.
« Nous avons espéré un moment pouvoir retirer cette fourchette mais cela n’a pas été possible et nous avons dû accepter aussi [de maintenir] le bas de la fourchette compte-tenu du fait qu’il nous fallait absolument l’unanimité » pour que la CDN soit validée, a confié à cet égard Monique Barbut.
[
Évolution et sécurisation du MACF
La France a obtenu des assurances concernant une évolution du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF en français, CBAM en anglais), se félicite-t-on au MTE. « La France demandait l’élargissement du MACF au secteur aval et une réforme avec la prise en compte de ce que l’on appelle les valeurs par défaut. En d’autres termes, la prise en compte du bilan carbone au niveau des pays et non au niveau des entreprises. C’est une façon d’éviter les manœuvres de contournement de cet instrument, pour assurer son étanchéité face aux manœuvres des États tiers, [ce que l’on appelle le] « resource-shuffling ». Un renforcement très important de cet instrument clé pour la neutralité climatique et l’alignement des stratégies carbone de nos partenaires avec l’ambition européenne a donc été obtenu. »
Le « resource-shuffling » ou transfert de ressources est une stratégie visant à éviter les fuites de carbone, dans le cadre de laquelle les producteurs ou négociants étrangers manipulent la comptabilité et les flux commerciaux en exportant leurs produits les plus propres et à faible teneur en carbone vers l’UE (afin de minimiser le coût du MACF), tout en détournant leurs productions plus polluantes et à fortes émissions vers des marchés non réglementés.
[
Report de l’ETS 2 de 2027 à 2028
Autre compromis, le report d’un an de l’application de SEQE-UE 2 (système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne) ou ETS 2 (European Union Emissions Trading System en anglais), le nouveau marché carbone qui couvrira les émissions de CO2 des énergies fossiles utilisées dans les secteurs du transport routier, du bâtiment, de la construction et de la petite industrie. « L’ETS 2 qui va porter en particulier sur l’effort des ménages via le chauffage, est très lourd socialement à porter. Aucun des pays d’Europe de l’Est n’était prêt à transposer cette obligation en droit national. Nous avons travaillé avec les Allemands à cette position de compromis de report », a précisé Monique Barbut.
Les marchés carbone sont des outils réglementaires visant à atteindre des objectifs de réduction des gaz à effet de serre déterminés politiquement. En 2005, l’Union européenne avait mis en place le SEQE-UE 1 (ETS 1), qui couvre les émissions de la grande industrie, les secteurs énergétiques, l’aviation et le maritime. Le SEQE-UE 2 (ETS 2), adopté en 2023, qui devait initialement être mis en place en 2027, est donc désormais retardé d’un an.
[
[
En savoir plus
2040 climate target: Council agrees its position on a 90% emissions reduction – Consilium
Contribution déterminée au niveau national (CDN) 2035 de l’UE